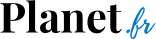Guillaume Durand : son cancer de la mâchoire, son cri d’alarme

Il y a des histoires qui font froid dans le dos parce qu’elles peuvent arriver à tout le monde. Celle de Guillaume Durand en fait partie. Pendant longtemps, le journaliste et animateur a cru à un problème banal, presque classique : un mal de dents qui s’éternise. Un souci gênant, oui… mais rien d’alarmant. Sauf que dans son cas, ce n’était pas une carie. Ce n’était pas “juste” une douleur à supporter. C’était un cancer de la mâchoire.
Et le plus troublant, dans son récit, c’est ce qu’il raconte sur la manière dont tout a été pris au départ. Guillaume Durand affirme que plusieurs professionnels se sont trompés. Pire : il dit avoir entendu des phrases qui, aujourd’hui, le révoltent encore. À commencer par cette réponse expéditive, presque désinvolte : “T’as qu’à prendre un Doliprane.” Une formule qui, dans la bouche d’un patient souffrant, peut sembler rassurante. Mais qui, dans son cas, a surtout fait perdre un temps précieux.
Ce témoignage, relayé notamment par Public.fr, n’a rien d’un simple “coup de com’”. Guillaume Durand ne cherche pas à se faire plaindre. Il raconte parce qu’il veut alerter. Parce qu’il sait qu’à sa place, beaucoup auraient fini par se taire, par douter d’eux-mêmes, par se dire que “ça va passer”. Or, parfois, ça ne passe pas. Et quand le corps envoie un signal, mieux vaut l’écouter.
Un mal de dents… puis la découverte d’une tumeur de 5 cm
Tout commence au printemps 2021. Une douleur. Une gêne dans la bouche. Une sensation qui n’a rien d’extraordinaire au départ. Comme beaucoup, Guillaume Durand consulte. Il cherche une solution simple. Un soin dentaire, un traitement, un antibiotique… quelque chose de logique.
Sauf que les jours passent, et la douleur reste. Elle revient. Elle s’installe. Elle s’intensifie. Et surtout, elle ne ressemble plus à un petit souci passager. Pourtant, à l’entendre, les réponses qu’il reçoit sont loin d’être à la hauteur de ce qu’il vit. On minimise. On rassure. On ne s’inquiète pas.
Le journaliste raconte même qu’une radiologue de la Pitié-Salpêtrière lui aurait lancé : “Vous n’avez rien, vous pouvez aller courir.” Une phrase qui, sur le moment, peut donner l’impression d’être une bonne nouvelle. Mais qui devient glaçante après coup, quand on comprend ce qui se passait réellement dans son corps.
Car oui, pendant que Guillaume Durand tentait de tenir bon, une tumeur progressait. Et pas une petite lésion “surveillée”. Une masse importante. Une tumeur de 5 centimètres, située au niveau de la mâchoire. Une taille impressionnante, qui explique l’urgence de la prise en charge une fois le diagnostic enfin posé.
Le couperet tombe après de nouveaux examens, une seconde intervention dentaire, puis une biopsie. Le résultat est terrible : carcinome épidermoïde. Un cancer sérieux, agressif, qui ne laisse pas beaucoup de marge. À ce moment-là, tout s’accélère. Et l’idée qui obsède Guillaume Durand, c’est celle-ci : si on l’avait pris au sérieux plus tôt, est-ce que tout aurait été moins lourd ? Moins violent ? Moins risqué ?
C’est ce qu’il appelle aujourd’hui une errance médicale. Pas forcément une “faute” au sens juridique, mais une succession de décisions, de sous-estimations, de rendez-vous qui n’ont pas déclenché les bonnes alarmes au bon moment. Et pour lui, le résultat est clair : le retard a laissé le cancer avancer.
Une opération de 11 heures et une greffe impressionnante
Quand la situation est jugée critique, les médecins n’ont plus le choix : il faut opérer. Et vite. Guillaume Durand se retrouve alors face à une réalité brutale. Ce n’est pas un “petit traitement”. Ce n’est pas une intervention légère. C’est une chirurgie lourde, longue, radicale.
Le journaliste raconte une opération d’environ onze heures, qu’il qualifie lui-même de “dantesque”. Le but : retirer ce qui doit l’être pour stopper la progression de la maladie… et reconstruire ce que le cancer a détruit ou menacé.
C’est là que son histoire devient presque irréelle. Pour reconstruire sa mâchoire, les chirurgiens utilisent une technique impressionnante : ils prélèvent un os dans sa jambe, au niveau du péroné, pour le greffer à la place de la partie manquante. Une opération de haute précision, appuyée par des outils de modélisation très poussés.
Guillaume Durand le résume avec une phrase qui marque :
“On m’a greffé un bout de jambe à la place de la mâchoire.”
Difficile d’imaginer ce que cela représente tant qu’on ne l’a pas vécu. Difficile aussi de mesurer l’impact psychologique d’une telle transformation. Parce qu’au-delà de la survie, il y a le “retour à la vie”. Le miroir. Le regard des autres. La fatigue. Les douleurs. Et le sentiment, parfois, de ne plus être tout à fait le même.
Après cette intervention, l’animateur explique avoir perdu 12 kilos. Il a dû réapprendre des gestes simples : manger, parler, articuler. Il raconte aussi que sa voix a changé, devenue plus grave. Un détail, peut-être, pour certains. Mais pour quelqu’un dont la parole est l’outil de travail, c’est un bouleversement immense.
Et surtout, il y a ce que personne ne voit sur une photo : la récupération. La lenteur. Les rendez-vous médicaux qui s’enchaînent. L’angoisse des contrôles. La peur d’une rechute. Le corps qui met du temps à se remettre d’un choc aussi violent.
“Je ne suis pas guéri” : des séquelles encore très présentes
Aujourd’hui, Guillaume Durand explique être en rémission depuis 2022. Sur le papier, c’est une victoire. Mais dans la vraie vie, il le dit clairement : il refuse de prononcer le mot “guéri”. Il le trouve trop définitif, presque dangereux. Comme si le simple fait de le dire pouvait porter malheur. Il l’affirme sans détour : “D’abord, je ne suis pas guéri.”
Dans ses prises de parole, il insiste aussi sur un point : l’évolution de la maladie reste “très aléatoire”. Autrement dit, rien n’est totalement certain. Et quand on a traversé une épreuve pareille, on comprend pourquoi il garde cette prudence.
Car même en rémission, tout ne revient pas “comme avant”. Il y a les douleurs, qui peuvent s’installer dans la durée. Il y a les habitudes qui changent. Il y a l’alimentation, parfois compliquée. Il y a une fatigue persistante. Et il y a cette phrase, encore une fois, très concrète, très humaine, qui résume tout :
“Ce n’est pas tout à fait naturel de manger avec un bout de sa jambe.”
C’est dit simplement, presque avec une forme de lucidité brute. Mais derrière, on entend la réalité d’un homme qui vit avec un corps reconstruit, réparé, mais marqué.
Ce n’est pas seulement une cicatrice. C’est une nouvelle façon de vivre. Une nouvelle vigilance. Une autre relation au temps. Et un autre rapport à la santé : plus inquiet, mais aussi plus conscient.
Un rythme de vie “à l’ancienne” et un message fort pour le public
Autre élément qui interpelle Guillaume Durand : ce cancer touche souvent des personnes ayant des facteurs de risque bien connus, comme le tabac ou l’alcool. Or lui affirme l’inverse : “Je n’ai jamais bu, jamais fumé.”
Alors forcément, une question revient : pourquoi ? Comment ? D’où ça vient ?
À défaut d’une réponse évidente, il s’interroge sur son rythme de vie. Celui d’un homme qui a travaillé énormément. Qui s’est levé très tôt pendant des années. Qui a vécu au pas de course, souvent sous pression. Un rythme que beaucoup de Français connaissent, surtout dans une génération où l’on ne s’arrêtait jamais.
Guillaume Durand parle de réveils à 4h ou 5h du matin, répétés pendant des décennies pour la radio. Il évoque l’usure. La fatigue chronique. Le stress. Et cette idée que le corps finit, un jour, par présenter la facture.
Dans son livre Bande de Français, il parle même de “dévoration de soi”. Une expression forte, qui colle bien à ce que vivent beaucoup de seniors : une vie entière à encaisser, à avancer, à tenir bon… jusqu’au moment où l’organisme dit stop.
Aujourd’hui, Guillaume Durand a choisi de ne pas garder tout ça pour lui. Il s’engage et devient parrain de la campagne “Rouge-Gorge”, destinée à sensibiliser aux cancers des voies aérodigestives. Et son message est limpide : ne jamais banaliser une douleur qui dure.
Parce que ce qu’il dénonce, au fond, ce n’est pas seulement un retard. C’est ce moment où un patient commence à douter de lui-même. Où il se dit : “Je dois exagérer.” “Ce n’est pas grave.” “On m’a dit que je n’avais rien.”
Lui en est la preuve : parfois, on a “quelque chose”. Et ce “quelque chose” peut être énorme.
Alors il le répète : si une douleur persiste, si quelque chose cloche, il faut insister. Demander un autre avis. Exiger des examens. Ne pas lâcher. Parce que dans certaines histoires, quelques semaines ou quelques mois peuvent tout changer.
Et dans la sienne, il le dit clairement : un “Doliprane” ne pouvait pas suffire.