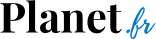Réforme des retraites : vers une grève semblable à celle de 1995 ?

Un pays paralysé comme il y a 27 ans ? Si la grève de 1995 semble un lointain souvenir pour certains, de nombreux Français n'ont pas oublié les trois semaines de mobilisation en plein hiver, regroupant la fonction publique, les étudiants, les lycéens, la SNCF, EDF-GDF, la RATP puis La Poste et France Télécom, suivis par les centres de tri.
Les métros ne circulent plus, les grandes villes sont paralysées et le mouvement prend de l'ampleur, montant jusqu'à deux millions de personnes dans les rues le 12 décembre 1995. Les grévistes s'appuient aussi sur le soutien de l'opinion, puisque 60% des Français soutiennent le mouvement. Le gouvernement d'Alain Juppé recule et annule sa réforme des retraites.
Grève du 19 janvier : un remake de 1995 ?
Si ce mouvement revient aujourd'hui sur le devant de la scène, ce n'est pas pour une leçon d'Histoire, mais parce que la mobilisation contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron pourrait être de la même ampleur cet hiver. Les syndicats se sont mis en ordre de bataille pour une première journée de contestations le jeudi 19 janvier et le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez table sur deux millions de manifestants.
Comme l'explique RMC, le mot d'ordre est mobilisation pour ces syndicats, qui distributent des tracts, organisent des réunions publiques, lancent des appels sur les réseaux sociaux et dans les médias. Tous seront mobilisés le 19 janvier et la branche pétrole de la CGT vient d'appeler à plusieurs mouvement de grève ce jour-là, le 26 janvier et le 6 février. "Baisse des débits" et "arrêt des expéditions" sont notamment prévus, selon un syndicaliste interrogé par l'Agence France-Presse, citée par RTL. L'arrêt de travail sera progressif, de 24 heures le 19 janvier, de 48 heures le 26 janiver et de 72 heures le 6 février.
Pour la première fois depuis 12 ans, les syndicats s'unissent dans la mobilisation et ils bénéficient du soutien de plus de la moitié des Français. Un scénario qui rappelle donc celui de 1995 mais à quoi faut-il s'attendre pour ce "jeudi noir" la semaine prochaine ? Tout ce que l'on sait ci-dessous.
Quels syndicats seront mobilisés ?

C’est la première fois depuis la réforme des retraites d’Eric Woerth, pendant la présidence de Nicolas Sarkozy, que les syndicats s’unissent dans la contestation. Le mouvement réuni la CFDT, la CGT, la CFE-CGC, la CFTC, FO, Unsa, Solidaires et FSU.
Qu’est-il prévu ?

Des manifestations dans les rues, mais aussi des grèves dans les administrations, dans les entreprises et dans les transports.
Un mouvement qui va durer ?

Personne ne peut le prédire, mais les syndicats préviennent d’ores et déjà qu’ils souhaitent inscrire le mouvement dans la durée. Après la mobilisation du 19 janvier, ils se réuniront le soir pour choisir une prochaine date.
Quels secteurs pourraient être les plus touchés ?

La mobilisation pourrait être plus forte dans les secteurs de l’énergie, des transports. Auprès de l’Agence France Presse, citée par BFMTV, des syndicats de EDF ou de RTE ou affirmé qu’il fallait s’attendre à un "conflit dur".
Qui, politiquement, soutient le mouvement ?

Les syndicats ont le soutien de l’ensemble de la gauche. La Nupes appelle à rejoindre le mouvement de contestation des syndicats.
Le Rassemblement national veut aussi rejoindre les manifestations.
Le soutien d’une partie des Français

Selon un sondage Elabe pour BFMTV, 60% des Français soutiennent la mobilisation contre la réforme des retraites et 46% des personnes interrogées se disent prêtes à se mobiliser dans les prochaines semaines.
Une grève dans la durée comme en 1995 ?

De nombreux Français se souviennent des grèves massives contre le plan Juppé en 1995 et la paralysie du pays pendant presque un mois. Deux millions de personnes étaient descendues dans les rues et le gouvernement avait dû renoncer aux mesures sur les retraites.
Mardi 10 janvier sur BFMTV, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a déclaré : "On peut même faire mieux" qu’en 1995 "parce qu’il y a du ras-le-bol".