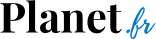Retraite : ces dispositifs de capitalisation que vous utilisez peut-être déjà sans le savoir

Si le modèle français repose largement sur un système par répartition, où les actifs d’aujourd’hui financent les pensions des retraités actuels, une part minoritaire du paysage repose déjà sur la capitalisation. Ce modèle repose sur une logique différente : chacun épargne pour lui-même, les sommes collectées étant placées sur les marchés financiers pour générer du rendement.
En France, la capitalisation reste aujourd’hui complémentaire à la répartition. Elle ne remplace pas la pension principale mais peut en améliorer le montant. D’ailleurs, selon un sondage BPCE de 2025, 53 % des Français se disent favorables à l’introduction d’une part de capitalisation, en complément du système existant. Mais la confiance dans les marchés financiers reste limitée : selon une autre enquête menée pour la CGT, seuls 29 % des sondés déclarent leur faire confiance pour assurer leur future retraite.
Des régimes déjà en place
Le RAFP (Régime de retraite additionnelle de la fonction publique) est le plus emblématique des régimes publics par capitalisation. Créé en 2005 pour compenser l'absence de cotisation retraite sur les primes des agents publics, il est aujourd’hui obligatoire pour les 4,4 millions de fonctionnaires. Chaque mois, 10 % des primes (5 % payés par l’agent, 5 % par l’employeur) sont investis dans un fonds. Grâce à une gestion performante, avec un rendement moyen de 4,3 % depuis 2005,ce régime permet de verser une rente annuelle moyenne de 484 euros à ses bénéficiaires (ou un capital, si les droits acquis sont faibles). Des revalorisations significatives ont eu lieu ces dernières années : +6,8 % en 2024, +4 % en 2025.
Autre exemple, plus discret : la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), un régime qui repose en grande partie sur la capitalisation. Avec 7,4 milliards d’euros d’actifs gérés, les revenus financiers permettent de verser les pensions complémentaires aux pharmaciens libéraux. Là encore, la capitalisation ne remplace pas la pension de base mais vient l’enrichir.
PER, Pereco, Article 83… la capitalisation côté privé
Dans le secteur privé, le Plan d’épargne retraite (PER) illustre parfaitement la logique de capitalisation individuelle. Créé en 2019, ce produit facultatif permet à chaque épargnant de constituer une épargne retraite déductible fiscalement. Il est principalement utilisé par les foyers imposables, donc à revenu moyen ou élevé. En ce sens, le PER ne constitue pas une solution universelle.
Pour les salariés, des dispositifs d’entreprise existent également : le Pereco (PER collectif) permet d’affecter l’intéressement ou la participation à l’épargne retraite. Facultatif, il est souvent encouragé fiscalement. Plus contraignant, l’ancien “article 83” (désormais PER obligatoire) impose aux salariés et employeurs de cotiser sur un plan d’épargne retraite collectif, avec versement sous forme de rente.
Si ces solutions restent aujourd’hui facultatives ou réservées à certaines catégories de population, elles incarnent déjà une forme de retraite par capitalisation intégrée au paysage français.
- Retraite : l’instant de malaise entre Gabriel Attal et Sandrine Rousseau sur la capitalisation
- Présidentielle 2027 : Bruno Retailleau officialise sa candidature et lance la bataille à droite
- Retraite : faites-vous partie des professions aux plus faibles pensions ?
- Retraite : comment fonctionne le système universel imaginé par Gabriel Attal ?