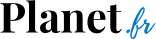Les fantômes de l’affaire Ranucci : Jean-Baptiste Rambla, la victime devenu tueur
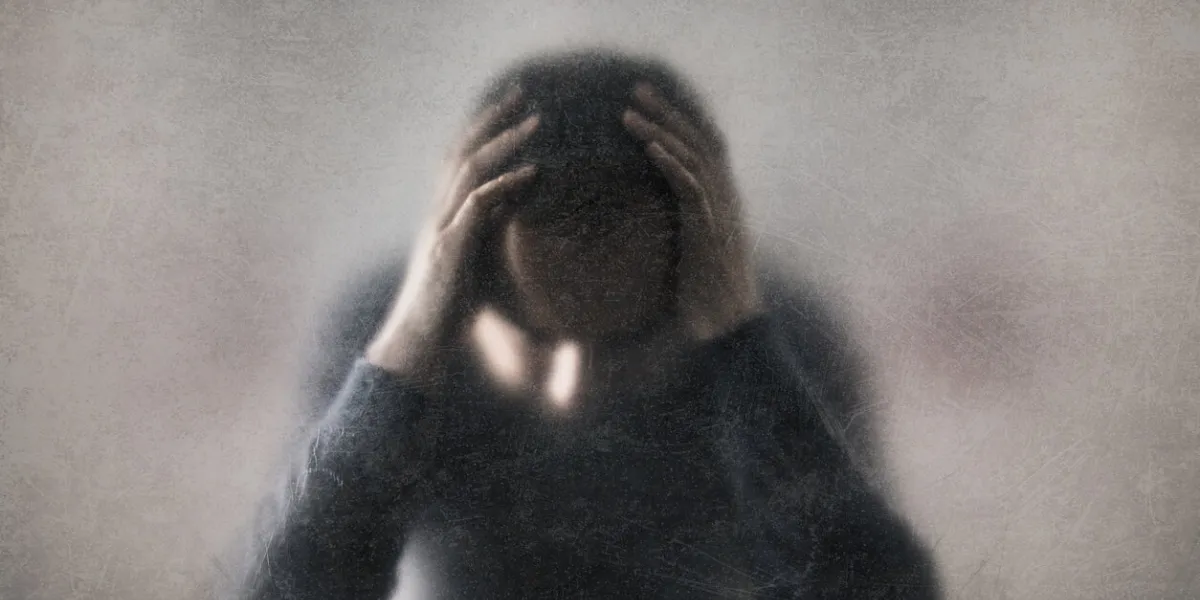
Jusqu’à la publication, en 1978, d’un livre de Gilles Perrault, Le Pull-over rouge, une sorte de contre-enquête qui voudrait prouver son innocence.
Pour la famille de Marie-Dolorès, c’est un nouveau combat qui s’ajoute à leur deuil et à leur soif de justice. Son frère, Jean-Baptiste, grandit dans l’ombre du crime, accablé par la colère familiale, à tel point qu’en 2004, à l’âge de 37 ans, il va à son tour commettre l’irréparable. Et récidivera, quelques années plus tard.
Vengeance, mystère et secrets de famille : Agnès Grossman a enquêté sur les « fantômes de l’affaire Ranucci » et publie un livre aux éditions Presses de la Cité. Entretien.
C’est l’une des affaires les plus emblématiques du siècle dernier, devenue insociable du débat autour de l’abolition de la peine de mort, qui sera abrogée défectivement en 1981.
Le 3 juin 1974, la France apprend avec émoi l’enlèvement de la petite Marie-Dolorès Rambla, 8 ans, devant son immeuble à Marseille. Elle y jouait avec son frère, Jean-Baptiste, 6 ans, lorsqu’un homme s’est approché des enfants et a insisté pour que la fillette l’aide à chercher son « chien noir ». Jean-Baptiste, sur les instructions de l’inconnu, part de son côté. Il ne reverra jamais sa sœur.
Deux jours plus tard, le corps de Marie-Dolorès est retrouvé non loin d’une route départementale, lardé d’une quinzaine de coups de couteau, et le crâne fracassé à coups de pierre. Très vite, une véritable chasse à l’homme s’enclenche pour retrouver le « monstre ». C’est un homme de 20 ans, Christian Ranucci, impliqué le jour du drame dans un accident non loin de là, qui fait rapidement figure de suspect numéro 1. En garde à vue, il avoue le crime, et on retrouve dans sa voiture un pantalon tâché de sang. Il explique aussi avoir caché l’arme du crime, un couteau à cran d’arrêt automatique, dans une champignonnière : il sera bien retrouvé sur place. Mis en examen, il ne tarde pas à se rétracter. Mais il est trop tard ; trop d’éléments le confondent.
Le 10 mars 1976, il est condamné à la peine de mort pour le meurtre de Marie-Dolorès Rambla. Le 28 juillet, il est conduit à l’échafaud à l’aube, et exécuté.
Deux ans plus tard, le journaliste Gilles Perrault publie une « contre-enquête » de l’affaire, : Le pull-over rouge, qui questionne point par point la culpabilité de Ranucci, et entraîne un véritable tollé médiatique. Les demandes de révision s’enchaînent, et on crie à l’erreur judiciaire, alors même que le débat sur l’abolition de la peine de mort fait rage.
Pour la famille de Marie-Dolorès, qui ne se remet pas du drame, l’affront est terrible. Le père, Pierre Rambla, se donne alors une mission : se battre en faveur dela peine de mort, et prouver que Ranucci était bien coupable.
Jean-Baptiste Rambla, un frère hanté par le crime
Son fils, Jean-Baptiste, grandit lui aussi la rage au ventre, en plus de devoir supporter la culpabilité d’avoir été témoin, à seulement 6 ans, du pire drame de son existence. Jusqu’au jour où il sombre, à son tour, dans le crime. En 2004, âge de 37 ans, il tue sa patronne, Corinne Beidl, 42 ans, et cache son corps dans son cabanon de jardin pendant 7 mois. Confondu, et condamné à 18 ans de réclusion criminelle, il expliquera, lors de son procès, être « hanté » par la disparition de sa sœur depuis toujours.
Il obtient une libération conditionnelle en 2015. A quelques jours seulement de la fin de sa période de probation, Jean-Baptiste Rambla cède à nouveau à ses démons. A Toulouse, il égorge une jeune étudiante, Cintia Lunimbu, sans raison apparente.
On parle de la « malédiction » des Rambla. Que s’est-il vraiment passé dans la tête du frère de la petite Marie-Dolorès ? Agnès Grossmann, journaliste, a longuement enquêté sur l’affaire et a publié, aux éditions des Presses de la Cité; L’affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci.
Pourquoi vous être intéressée à cette affaire ?
Agnès Grossmann : J’ai travaillé pour l’émission Faites entrer l’accusé, j’avais donc bien évidemment suivi l’affaire Ranucci. Je savais qu’il y avait eu une forme de manipulation médiatique. L’histoire, à l’époque, a été racontée autrement. On avait médiatisé l'« innocence » supposée de Ranucci car cela « servait » la lutte contre la peine de mort.
Un jour, on a appris que Jean-Baptiste Rambla avait tué quelqu’un. jJe n’ai pas pu m’empêcher de penser que son geste était lié au mensonge. J’ai toujours eu beaucoup de compassion pour cette famille, et je trouvais que c’était terrible pour eux, cette manipulation médiatique.
Son crime m’a mis mal à l’aise, évidemment. Et puis quand il a tué une deuxième fois, je me suis dit : il faut creuser. J’avais un terrain, et puis finalement personne n’en parlait. L’histoire de ses crimes n’avait finalement jamais été racontée comme cela.
A quoi ressemble la famille Rambla, avant le drame qu’est l’enlèvement de Marie-Dolorès ?
Agnès Grossmann : C’est une famille d’immigrés espagnols, ils ont quatre enfants et vivent dans une cité de Marseille. C’est une famille très modeste mais très heureuse.
Le père, Pierre, a une vie très difficile. Il est né d’une famille d’agriculteurs, il a perdu son père très tôt, il a toujours travaillé énormément de ses mains, ce qui ne lui as pas laissé le temps pour la légèreté. Il a rencontré sa femme Dolores au village, ce fut le un coup de foudre, et ils ont décidé de faire leur vie en France où Pierre avait déjà travaillé. Ils voulaient une vie heureuse, autour de leur famille. Ils ont eu leurs quatre enfants, Marie-Dolorès, l’ainée, Jean-Baptiste, le cadet, et puis des jumeaux.
Pierre adorait sa fille Marie-Dolorès. Et malheureusement, on lui a tué sa fille. Ça a été un drame terrible pour lui et il n’avait pas assez de « réserves » de bonheur pour faire face. Cette colère qu’il a entretenu pendant toutes ces années, c’était une façon de lutter contre la dépression, de survivre.
Jean-Baptiste Rambla : « ce reproche va l’écraser »
Jean-Baptiste Rambla assiste à l’enlèvement de sa sœur Dolores en juin 1974. Qu’est ce qu’il en raconte aux enquêteurs ?
Agnès Grossmann : Ils sont en train de jouer devant l’immeuble, un homme arrive, il leur dit : « j’ai perdu mon chien noir ». Il demande alors à Jean-Baptiste d’aller chercher par là-bas, et explique qu’il va chercher de l’autre côté avec la petite Marie-Dolorès. Jean-Baptiste a 6 ans, il obtempère.s
Deux jours plus tard, Marie Dolorès est retrouvée morte. Elle a été assassinée de plusieurs coups de couteau.
Comment vit-il le drame ? L’enquête, la médiatisation ?
Agnès Grossmann : Il a 6 ans, il ne se rend pas vraiment compte de ce qu’il se passe. Mais son père va faire peser une certaine culpabilité sur ses épaules. Il lui dit : « tu as laissé ta sœur partir seule avec l’inconnu ». Il va beaucoup lui en vouloir. Evidemment, Jean-Baptiste n’avait que 6 ans, il ne pouvait pas faire autrement, il n’était pas coupable. Mais ce reproche va l’écraser, et la petite Marie-Dolorès hante la famille, c’est une catastrophe, et il en porte la responsabilité.
Quels sont les éléments qui confondent définitivement Ranucci dans l’enlèvement et le meurtre de Marie-Dolorès Rambla ? Et les éléments qui sèment le doute quant à sa culpabilité ?
Agnès Grossmann : Lui va avouer de façon extrêmement circonstanciée, en racontant tout le déroulé du crime et de sa fuite, ce qui correspond aux constations. Il a un accident, qui est confirmé par des témoins, il dit où est l’arme du crime, un pantalon plein de sang sera retrouvé dans sa voiture... Et même quand il se rétractera, il dira que le couteau retrouvé dans la champignonnière est pourtant bien le sien. C’est, en tout cas, un jeune homme très perturbé.
A priori donc, rien ne l’innocente. Sauf que la procédure est un peu lâche. Il y a des trous, qui permettent à Gilles Perrault de s’immiscer et de créer le doute. Par exemple, quand la juge organise la reconstitution, elle ne va pas décider de le faire, sur place dans la cité ; car il y a eu des menaces de mort autour de Ranucci.
Et puis, il y a le fait aussi que le petit garçon Jean-Baptiste ne va pas le reconnaitre. Jean-Baptiste est confronté très tôt dans l’enquête à un tapissage, au cours duquel il ne va pas reconnaitre Ranucci comme le ravisseur de sa sœur. Son père, d'ailleurs, va également lui en vouloir pour ça.
Sauf qu’une fois de plus, il était très jeune, sous le choc et fatigué. Et puis, Ranucci avait déjà essayé d’enlever deux enfants avant, et là aussi, bien que les parents l’aient reconnu, les enfants, eux, n'étaient pas parvenus à le reconnaitre.
Jean-Baptiste Rambla : inconstance et addictions, la vie cabossée du « frère de Marie-Dolorès »
La publication du Pull-over rouge en 1978 : comment le vit la famille ?
Agnès Grossmann : Jean-Denis Bredin, l’associé de Robert Badinter, qui travaillait déjà sur l’abolition de la peine de mort, va demander à l’époque à Gilles Perrault de se pencher sur cette affaire. En réalité, ils ont voulu faire bouger l’opinion publique en se servant de l’affaire. Pour la famille, c’est comme si on tuait une deuxième fois leur fille. Car le livre de Gilles Perrault convainc l’opinion publique, et Ranucci devient la victime : c’est terrible pour eux. La justice reste pourtant inflexible, est les demandes de révision sont toutes rejetées.
Comment se déroule la vie de Jean-Baptiste Rambla : comment grandit-il, quel genre d’homme devient-il ?
Agnès Grossmann : Il ne grandit pas bien. Quand il est petit, il prend des somnifères, qu’il remplace à l’adolescence par du cannabis et plus tard de la cocaïne. Il a du mal à s’investir dans les études, son père passe son temps à l’entrainer dans des manifs pour revendiquer la peine de mort, ce qui n’est pas l’idéal pour grandir de façon équilibrée. Il n’est que le « frère de Marie-Dolores », dont le couvert est encore mis tous les soirs à table. La famille vit avec son fantôme.
Jean-Baptiste va ensuite faire l’armée, il va aimer ça, car il peut alors fuir en quelque sorte cette famille, une famille très déprimée, avec des conflits entre les parents, car sa mère veut tourner la page et son père non.
Il trouve ensuite des petits boulots, où on le trouve plutôt compétent. Et puis, sentimentalement, il est un peu inconstant, il est très coureur, il a du mal à se poser. Il a du succès avec les femmes ; c’est un beau garçon. Ça le rassure, c’est une réparation narcissique. C’est un Dom Juan comme on dit. Il vivote de petit métier en petit métier. C’est quelqu’un de globalement perturbé ; mais c’est un bosseur. Grâce à son père, il trouve un boulot dans une cantine sur les plateaux de cinéma. C’est là qu’il rencontre sa future victime, Corinne Beidl.
Jean-Baptiste Rambla : triste « vendetta »
Le 13 juillet 2004, Jean-Baptiste Rambla tue sa patronne, Corinne Beidl. Que s’est-il passé ?
Agnès Grossmann : On peut dire que c’est un crime de colère. Lui dit qu’ils avaient une aventure amoureuse ensemble, et qu’elle serait venue chez lui pour avoir une relation sexuelle ce jour-là. Il refuse, car il souhaite à ce moment reconquérir sa femme, et Corinne l'aurait insulté. Il aurait alors « explosé », il ne sait pas trop pourquoi. Il a dit plus tard que lorsqu’il l’avait eu en face d’elle, ce n’était pas elle qu’il voyait, c’était tous les gens qui ont fait du mal à sa famille. En gros, Jean-Baptiste Rambla, c’est quelqu’un qui veut venger sa famille, c’est un peu une vendetta.
Il est arrêté, vu par des psys, il raconte son histoire. C’est un homme normal, il ne souffre d’aucune pathologie. Il est conscient de ce qu’il fait. Mais est-ce qu’on est vraiment conscient de ce qu’on fait quand on est dans une grande colère ? Il est condamné, et en prison, il n’est pas mal finalement. On s’intéresse à lui, on s’occupe de lui, il est au calme. Il est, d'ailleurs, dans la même prison que Ranucci : il est dans ses pas.
Il est libéré en février 2015. Deux ans plus tard, il tue la jeune Cintia, 21 ans, qu’il ne connaissait pas. Comment expliquer cette récidive ?
Agnès Grossman : Lorsque le drame se produit, il n’a même pas fini sa période de probation, il est à quelques semaines de la finir, et il tue une deuxième fois. Il était dans la rue et a vu, à sa fenêtre, la jeune Cintia. Il raconte que la veille, il s’est fait agresser par un couple. Sous l’emprise de la cocaïne, il croit que Cintia est la femme du couple. Il monte, frappe à sa porte et la tue. Cintia est la première fille d’un couple d’angolais venus chercher en France une vie meilleure, elle a le même profil que la petite Marie-Dolorès. Je pense que puisqu'il n’avait pas réussi à rétablir la culpabilité de Ranucci lors de son premier procès pour le meurtre de Corinne, et que son père entre temps est mort, c’est désormais sa mission à lui seul, il a eu ce besoin de retourner devant la justice, car c’est sa seule tribune. Il a même dit « faut faire tout ça pour se faire entendre ». Il finalement a été entendu lors de ce deuxième procès, il a tenu la promesse de son père.
On peut penser que Corinne et Cintia sont des dégâts collatéraux de la manipulation médiatique. Ce que la famille n’a pas supporté, c’est la manipulation et la permanence du doute : car Gilles Perrault ne s’est pas arrêté au Pull-over rouge, il a fait 4 livres au total, le doute ne s’est jamais dissipé.
Jean-Baptiste Rambla : « tuer la sœur »
A-t-il été libéré trop tôt ? Y avait-il un risque récidive évalué par les experts ?
Agnès Grossman : Non, bien sûr que non, tous les feux étaient au vert. C’est ça qui est curieux, on ne peut pas savoir pourquoi quelqu’un tue.
Il n’a tué que des femmes… Pourquoi selon vous ?
Agnès Grossman : Les psychiatres ne donnent pas d’explication. C’est plus facile de tuer des femmes, bien sûr, mais on ne sait pas vraiment. Est-ce qu’il ne tuerait sa sœur une nouvelle fois ? Est-ce qu’il ne lui en voudrait pas énormément ? Parce qu’elle est montée dans la voiture… C’est délirant, mais est-ce qu’il n’a pas une haine profonde et inavouable envers cette sœur qui bien malgré elle a gâché sa vie… Il a tué Cinita comme sa sœur a été tuée.
Le 17 décembre 2020, il est condamné à la réclusion à perpétuité, peine assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans pour le meurtre de Cintia. Lors de son procès, il a déclaré : « Je ne me sens pas coupable » : comment expliquer ces paroles ?
Agnès Grossman : Alors, il se sent coupable mais pas responsable. Il est coupable, c’est lui, c’est évident pour lui, et il s’excuse auprès des parents, en leur disant « je comprends ce que vous vivez, je l’ai vécu moi-même ». Mais il considère que les responsables, ce sont avant tout ceux qui l’ont mis en colère, lui et sa famille.
Comment son père, Pierre Rambla, décédé en 2013, a-t-il vécu la première condamnation de son fils ?
Agnès Grossman : Il trouve ça terrible, mais il est convaincu que c’est toute cette histoire qui a fait basculer son fils. Son fils a enfin rejoint le banc des coupables qu’on lui attribuait depuis toujours.
Pierre Rambla était un brave homme, qui a été emporté par l’histoire dramatique de sa famille.
Son seul vrai combat, c’était respecter la mémoire de sa fille.
Ce qui es très étonnant, c’est que cette histoire a servi à l’abolition de la peine de mort, et que ça a marché. S’il y avait encore eu la peine capitale, Jean-Baptiste Rambla aurait lui-même risqué la peine de mort.
Pierre Rambla, qui a lutté toute sa vie contre l’abolition de la peine de mort, a donc dû être bien content que son fils y réchappe. A l’époque, il dira qu’il ne soutient en réalité la peine de mort plus que pour les récidivistes. Heureusement, donc, qu’il n’a pas vu son fils récidiver...
L’affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci, Agnès Grossman, 19 €, Les Presses de la Cité.