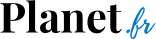Pesticides : ce département est le champion français des traitements chimiques

Les pesticides sont partout dans l’agriculture française. Pourtant, leur dangerosité ne fait plus débat : l’Organisation mondiale de la santé les classe parmi les substances “potentiellement toxiques pour les êtres humains”. Respiratoires, neurologiques, endocriniennes… les pathologies liées à l’exposition sont multiples. Et à cela s’ajoute une pollution diffuse mais massive de l’environnement : nappes phréatiques contaminées, sols appauvris, biodiversité en recul.
Pourtant, malgré ces constats alarmants, leur usage continue. L’agriculture française, encore largement structurée autour de logiques de rendement, peine à s’émanciper de ces traitements chimiques. Selon l’association Solagro, l’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) est passé de 2,36 à 2,37 entre 2020 et 2022. Une hausse minime en apparence, mais révélatrice d’un immobilisme profond, surtout dans certains territoires.
Quand l’agriculture intensive bat des records
C’est dans le département de l’Indre que les chiffres explosent. L’étude de Solagro place ce territoire en tête des départements français les plus utilisateurs de pesticides. Et les raisons sont claires : monocultures de blé tendre, orge, colza et vigne dominent le paysage agricole. À elles seules, ces cultures concentrent 67 % des traitements chimiques recensés à l’échelle nationale. Le blé, pilier de l’agriculture du département, représente à lui seul 36 % de la fréquence totale des traitements en France.
Cette spécialisation agricole rend les cultures particulièrement vulnérables aux maladies et ravageurs. La diversité végétale étant quasi absente, les sols sont épuisés et les auxiliaires naturels (comme les insectes pollinisateurs) disparaissent. Un cercle vicieux se crée, forçant les agriculteurs à traiter davantage pour garantir des rendements constants.
Des alternatives qui peinent à s’imposer
Face à ce constat, les solutions ne manquent pas. Rotation des cultures, désherbage mécanique, introduction de prédateurs naturels ou encore agriculture biologique sont autant de pratiques capables de réduire la dépendance aux produits chimiques. Mais leur adoption reste marginale.
Les raisons sont multiples : manque de formation, absence de soutien technique, peur de la baisse de rendement, pressions économiques… Sans politique d’accompagnement ambitieuse et sans valorisation des pratiques durables, le changement de cap reste hypothétique. Pourtant, la France s’est engagée à réduire de moitié l’usage des pesticides d’ici à 2030. Un objectif qui, au vu des tendances actuelles, semble encore bien loin.