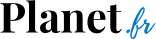Femmes criminelles : stéréotypes et réalités sur un « tabou » qui fascine

En France, selon les statistiques, elles sont bien moins nombreuses que les hommes à commettre des actes répréhensibles. Les femmes ne représentent que 3,6% de la population carcérale et 17% des 2,1 millions d’auteurs des affaires traitées par les parquets en 2016, selon les données du ministère de la Justice.
Pour autant, leurs actes alimentent très souvent les pires fantasmes et nourrissent des stéréotypes bien ancrés dans nos sociétés. Les affaires où elles se retrouvent sur le banc des accusés font souvent les gros titres, et sont largement suivies, commentées, décryptées.
Car l’imaginaire collectif « patriarcal » imagine plutôt la figure féminine comme une « proie » plutôt qu’un bourreau.
Femmes criminelles : séparer la réalité du fantasme
Pourtant, les femmes, elles aussi, peuvent sombrer dans la violence et la criminalité. Catherine Ménabé, maître de conférences en droit privé à l’université de Lorraine s’est penchée sur leur cas, dans un ouvrage, La criminalité féminine. Son but : décortiquer le crime au féminin pour séparer la réalité du fantasme.
Nous lui avons posé toutes nos questions sur le sujet.
Pourquoi vous êtes-vous intéressée à la criminalité féminine ?
Catherine Ménabé : J’avais eu l’occasion de m’intéresser aux statistiques pénales pendant mon mémoire, et j’ai constaté que les femmes ne représentaient que 3% des personnes incarcérées en France. Elles donnent l’impression de commettre moins d’infractions que les hommes, dans des proportions très franches. Cela m’a interpellé, alors j’ai poursuivi ce travail en doctorat : je suis partie de ce constat, et j’ai creusé la question, pour voir si les chiffres reflétaient vraiment la réalité criminelle.
Comment avez-vous procédé ? Avez-vous étudié la jurisprudence, certaines affaires, certaines personnalités en particulier ?
En droit, nous avons a une méthodologie particulière : on fait principalement de l’analyse de sources documentaires ou jurisprudentielles. Il y a peu d’enquêtes de terrain, par manque de temps, mais si cela reste l’un de mes projets.
J’ai étudié beaucoup d’analyses statistiques, pour voir l'évolution de cette criminalité féminine dans le temps, qui est d’ailleurs assez minime, et voir quelles sont les infractions commises par les femmes, celles qui sont effectivement sanctionnées, et celles qui donnent lieu à une incarcération, car il peut y avoir des variations au fur et à mesure de la chaine pénale.
Je me suis aussi basée sur des sources documentaires, des histoires de vie, retracées par d’autres, notamment dans le cadre d’infractions plus particulières comme les infanticides et les violences sexuelles.
Les particularités du crime au féminin
Quelles sont selon vous les particularités du crime au féminin ?
Catherine Ménabé : je pense que sa plus grande particularité, c’est que les femmes commettent moins d’infractions, et cet aspect quantitatif est aussi une question dans mon travail : est-ce représentatif de la réalité ? Est-ce qu’il n’y a pas une sous judiciarisation des femmes ?
Mais toutes les études sur la délinquance réelle amènent à dire que, certes, ce que l’on voit c’est inférieur à la réalité, mais cette proportion est vraie : il y a moins de femmes criminelles que d’hommes.
C’est une réalité les femmes commettent moins d’infractions, alors même que l’on évolue vers la parité entre les sexes. C’est intéressant d’un point de vue philosophique et sociologique, cela amène à constater que les différences entre hommes et femmes subsistent en matière criminelle et pénale.
Pourquoi ? Mes hypothèses c’est qu’il y a deux degrés. Le fait qu’elles commettent moins d’infractions serait lié à une socialisation différenciée. On ne nait pas femme, on le devient : on genre à minima, même si la société évolue, ça existe encore. Tout ça, c’est un ensemble, on a tendance à ne pas réclamer la même chose, et à ne pas accepter le même type de comportement, de la part d’une fille ou d’un garçon.
Ce qui, à priori, amène à ce que les comportements acquis soient différents entre hommes et femmes. Face à une difficulté, ils ne réagiront pas de la même manière.
On le dit beaucoup en psychologie, mais les conséquences en victimologie sont différentes : par exemple, les hommes victimes vont retourner la violence contre les autres. Les femmes, elles, ont plus tendance à la retourner contre elles-mêmes.
Quelle image l’opinion publique a-t-elle des « femmes criminelles » ? En quoi diffère-t-elle de la réalité selon vous ?
C’est un point au cœur de mon travail, la déconstruction de certains mythes. Les stéréotypes existent, il y a une image préconçue de la criminalité des femmes et également de la criminalité des hommes, et je me suis dit que j’allais partir de ces stéréotypes et voir s’ils étaient réels.
Quand on demande aux personnes ce qu’elles imaginent être la criminalité des femmes, on entend des choses comme les infanticides, qui sont d’ailleurs une vraie réalité, mais d’autres constats infondés comme l’empoisonnement, une image ancienne construire autour d’un imaginaire populaire avec de grandes affaires, les sorcières etc… Il y a aussi l’idée que la femme concentrerait son activité criminelle au sein du foyer : contre son conjoint, ses enfants…
A l’inverse, on pense la femme a criminelle en matière de violences sexuelles, qui reste l’un des principaux tabous, même si quelques affaires ont conduit à une certaine prise de conscience.
Et puis, à l’image des affaires Outreau ou Fourniret, on pense qu’une femme agit forcément avec un homme, que la femme auteure de violences sexuelles, c’est forcément au sein d’un couple, alors qu’il existe des femmes actives et seules.
Lire aussi : Affaire Dutroux : qui est Michelle Martin, ex-femme du tueur ?
Il y a cette construction stéréotypée des infractions que les femmes commettent et qu’elles ne commettent pas.
Tout cela est tellement ancré qu’il y a souvent une réaction différenciée : pour telle infraction, on va immédiatement penser que c’est un homme l’auteur. On trouve aussi des excuses, des justifications, aux femmes : on va dire « certes c’est un voleuse, mais c’est aussi un mère de famille ». L’ensemble de ces éléments, perçus et stéréotypés, conduisent à une réaction pénale différente, moins de poursuites, de condamnations, un aménagement de peine souvent facilité…
C’est très net d’un point de vue statistique : les femmes représentent 18% des mis en cause, 10% des personnes condamnées et 3% des personnes incarcérées.
Affaires Fiona, Sauvage, Cottrez : l’incompréhension et la fascination
Les crimes de femmes sont souvent très médiatisés en France (Affaire Fiona, Dominique Cottrez, Jacqueline Sauvage..) Comment l’expliquer ?
Catherine Ménabé : Il y a ce stéréotype que les femmes commettent moins de crimes, mais cela conduit à ce que, lorsqu’elles en commettent un, cela parait exceptionnel. Il y a donc toujours cet intérêt général de la population pour ce qui est exceptionnel, hors norme, et aussi contraire aux rôles sociaux.
Cela interpelle : on se dit, dans l’affaire Fiona, par exemple, c’est pas possible, ce geste est en totale contradiction avec l’aspect maternel, car la femme est souvent rattachée à son rôle de mère. Cela parait inconvenable, donc on en parle, on cherche peut-être à comprendre indirectement comment on peut en arriver là.
Deuxième aspect, dans l’affaire Jacqueline Sauvage, lorsqu’elle était présentée comme une meurtrière, on ne s’intéressait pas à son cas. Mais quand elle a été présentée comme une femme victime de violences conjugales qui s’est libérée après des années de sévices, on s’est intéressée à elle. Il y a une construction médiatique autour de la femme victime, et cet aspect on le retrouve beaucoup dans les stratégies des avocats.
On présente la femme presque dans l’un de ses rôles « habituels », qui serait la femme vulnérable. C’est très intéressant par rapport aux théories féministes, ça interroge vraiment sur la place de la femme dans la société.
Les crimes et les profils les plus courants chez les femmes criminelles
Quel est le type de profil le plus courant chez les femmes criminelles ?
Catherine Ménabé : Il n’y ’a pas vraiment de particularité par rapport aux hommes criminels dans le profil général. Au niveau des facteurs criminogènes (faible niveau socioéconomique, antécédents victimologiques), on va retrouver la même chose. La majorité des auteurs d’infractions commettent des infractions de profit, ou plus particulièrement dans le cas des violences sexuelles, parce qu’eux même en ont subi.
Chez les femmes, la seule particularité légère c’est que l’on retrouve ce dernier constat de manière plus marquée. 80% des femmes auteurs ont subi des antécédents de violence sexuelle au cours de leur vie.
On a aussi plutôt tendance à penser que ce sont celles qui accumulent le plus de facteurs qui passent à l’acte, mais il y a en réalité une forme de seuil de tolérance plus important chez les femmes.
Quelles sont les infractions, les crimes les plus courants ?
Le crime plus commis numériquement par les femmes que par les hommes, c’est l’infanticide, ou meurtre sur mineur de 15 ans selon l’appellation du code pénal, principalement sur des plus jeunes enfants.
Autre infraction très représentée, comme on aurait pu le deviner : la non représentation d’enfant.
Donc là c’est intéressant, car dans les deux cas, c’est lié à l’enfant. Les rôles sociaux sont la base des stéréotypes, mais aussi la base de la réalité de la criminalité féminine.
Et puis, il y a des infractions pour lesquelles le sex ratio augmente (globalement elles vont représenter 10% des condamnés sur l’ensemble des infractions, mais sur certaines infractions elles représentent plus, voire bien plus). Il y a trois catégories où celui-ci est plus marqué pour les femmes : dans le terrorisme, elles sont assez présentes. En matière de proxénétisme, également. Et, curieusement, dans la délinquance d’affaires, où elles représentent 30% des auteurs, alors même qu’elles possèdent beaucoup moins de postes à responsabilités en entreprise que les hommes encore aujourd’hui.
Femmes criminelles : le mythe du poison et l’emprise
Les femmes sont elles vraiment adeptes de certaines « armes » comme le veut la légende populaire (par exemple, le poison…) quand on attribue plus facilement aux hommes des armes de poing ?
Catherine Ménabé : Tout ceci est lié à des opportunités. L’accès en France à l’arme à feu est plus réglementé, donc il n’y a pas tant que ça d’homicides par armes à feu, hormis dans un contexte crapuleux. Surtout, les hommes ont aussi plus accès aux armes de part leurs activités éventuelles (chasse, tir de loisir...).
Globalement, on va être dans un mode opératoire d’opportunité, le plus souvent par arme blanche, et lié à la catégorie d’homicide. Par exemple, dans le cas d’un meurtre conjugal, la femme va empoigner un couteau qui se trouve dans la cuisine au moment de la dispute.
Il n’y a pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes de ce côté-là.
On pense souvent que les femmes ne peuvent pas commettre certains meurtres ou certaines formes de violence, mais c’est faux. Il y a très peu d’infractions qui nécessitent un niveau de violence qui n’est pas accessible aux femmes.
Le mobile et l’origine du crime chez les femmes diffère-t-il par rapport à celui des hommes ?
Dans le cas de « crimes passionnels », certaines études ont tendance à conclure que les hommes et les femmes ne tuent pas pour les mêmes raisons. Dans un contexte conjugal, les hommes vont tuer pour garder leur partenaire, c’est-à-dire lorsqu’elle cherche à partir.
Là où les femmes ont tendance à tuer pour se débarrasser, dans un sens large (cela peut aussi être pour une victime de violence le seul moyen de s’en sortir).
Mais il y a aussi une grosse nuance entre ce qui est discuté dans un procès et la réalité d’un mobile, et ça c’est difficile scientifiquement de réussir à avoir une étude vraiment concrète à ce niveau.
Lire aussi : Nancy Crampton Brophy : l'auteure de « Comment tuer son mari » condamnée pour le meurtre de son époux
Femmes auteures de violences sexuelles : le tabou et la réalité
Violences sexuelles, conjugales… Retrouve-t-on souvent des femmes sur le banc des accusés dans ce type d’affaire ? Y’a-t-il un tabou à ce sujet ?
Catherine Ménabé : il existe un vrai tabou, sur les femmes auteures de violences sexuelles et physiques.
Il y a une absence de conception de la femme violente. Dans une relation de couple, on estime qu’il y a la partie forte et la partie faible, et ça ne peut pas être la partie faible qui va être violente.
Même si aujourd’hui, on voit moins la femme comme une partie faible, il y a quand même une pression des associations féministes de ne pas vouloir parler des femmes auteures de violences conjugales, parce que ce serait peut-être une manière de minimiser la violence des hommes. Il y a beaucoup de discussions sur les violences conjugales en tant que symbole du patriarcat, et donc les femmes ne peuvent pas dans ce sens en être les auteures.
C’est une erreur à mon sens de penser les violences conjugales de ce point de vue, parce qu’effectivement, que ce soit un homme ou une femme, on aura toujours le même type de schéma : l’emprise, la lune de miel etc… Que que soit le sexe.
Ça biaise : on ne parle que des féminicides mais c’est une partie des violences conjugales, et les femmes auteures représentent une part beaucoup plus importante que ce qui est vu. En comptant les morts, on sait que c’est un homme tous les 12 ou 13 jours, ce qui n’est pas négligeable.
Cette part est minimisée, mais ça ne veut pas dire qu’il y a plus de femmes auteures que d’hommes.
Lire aussi : « J’étais sa chose, son objet » : Maxime Gaget, homme battu, a survécu à sa femme violente
On oublie aussi de parler des violences réciproques. Il n’est pas rare qu’on ait deux membres du couple poursuivis pour des violences, et il n’est pas rare de voir l’homme poursuivi et pas la femme, et des différences de peines très significatives.
C’est une catégorie d’infractions où il y a encore un tabou, on ne veut pas dire que la femme est l’égale de l’homme dans ce champ-là.
Quand aux violences sexuelles, là on touche à l’inconcevable. On n’imagine pas la femme comme une potentielle prédatrice, on a tendance à imaginer que la sexualité est l’apanage des hommes, ce sont eux qui sont demandeurs et potentiels agresseurs. Et encore, en ce qui concerne les enfants, on se dit que c’est d’autant plus inconcevable alors qu’en tant que femme et mère, c’est une protectrice de l’enfant.
La récidive est -elle courante chez les femmes ?
Moins que les hommes, c’est aussi une des explications sur le fait qu’elles sont moins incarcérées.
Une étude de l’administration pénitentiaire, concluait même que le facteur le plus important dans le risque de récidive, c’est le sexe. Le taux de rechute est moins élevé chez les femmes, c’est une réalité.
« C’est un stéréotype de penser que la femme est moins dangereuse que l’homme »
La justice n’est donc pas « plus dure » vis-à-vis des femmes ?
Catherine Ménabé : Les conceptions ont évolué. Il y a 30-40 ans, on avait la théorie du facteur chevaleresque, paternaliste. On imaginait la justice comme étant majoritairement composée d’hommes, qui se comportaient comme des pères, des chevaliers à l’égard des femmes, avec un traitement judiciaire qui paraissait préférentiel.
Mais cette théorie a démontré ces limites avec la féminisation de la justice, très notable. Aujourd’hui la proportion de magistrats femmes pas négligeable. Et cette théorie a été remplacée par celle du traitement différencié, l’idée c’est de dire que les magistrats hommes ou femmes ne perçoivent pas en face d’eux un homme ou une femme, ils perçoivent un criminel.
Mais inconsciemment, il va y a voir plusieurs facteurs qui interviennent dans leur décision ; face à une femme, on se dit que son risque de récidive est moins important, ou encore qu’une majorité de femmes sont des mères de famille, parfois avec des enfants à charge exclusive, ce qui joue en matière d’incarcération.
Quant au jury populaire, c’est difficile à démontrer mais il y a tout de même cette idée au cours d’un procès d’insister sur la conformité de la femme ou son absence de conformité à ses rôles sociaux prédéfinis. Cela peut avoir une incidence sur la peine.
Une femme qui tue son conjoint, par exemple, on va mettre en avant le fait qu’elle a toujours pris soin de ses enfants, et elle retrouve une image conforme à ce que l’on imagine. La peine prononcée n’a pas besoin d’être trop sévère.
Dans l’affaire Cottrez, par exemple, on se dit qu’en fait elle était victime, bien avant d’être coupable. On ramène la femme à ce qu’elle est censée être.
Lire aussi : Infanticides multiples : ces mères qui ont tué plusieurs de leurs enfants
Evidemment, c’est plus compliqué quand une femme est poursuivie pour des violences sexuelles.
Il y a un exemple intéressant sur le traitement des femmes par la justice. Lors d’un colloque sur les femmes terroristes, un des membres de la section antiterroriste nous disait que pendant longtemps, quand une femme revenait de la zone irako-syrienne, elle était placée sous contrôle judiciaire, alors que les hommes eux, étaient placés en détention provisoire.
On se disait que dans la radicalisation islamique, de toute façon, c’était l’homme le combattant, et la femme était reléguée à un rôle logistique, d’éducation, donc elle ne paraissait pas aussi dangereuse.
L’affaire des bonbonnes de gaz de Notre-Dame a changé la donne, et il y a eu une prise de conscience de la dangerosité de certaines femmes.
C’est un stéréotype de penser que la femme est moins dangereuse que l’homme.
Retrouve-t-on les mêmes troubles psychiatriques chez les femmes criminelles que chez les hommes criminels ?
La quasi-totalité des troubles peuvent être masculins ou féminins. Mais les psychiatres expliquent qu’il y a des troubles psychopathologiques ou psychiatriques plus masculins ou féminins, et des âges d’apparition différents.
Par contre, je pense aux psychopathes et aux sociopathes, on va en retrouver chez les tueurs en série, la grande majorité d’entre eux le sont, et chez les femmes tueuses en série, on retrouve souvent ce trouble aussi.
Lire aussi : Elle jetait des enfants par la fenêtre : qui était Johanna Alvater, “la pire femme nazie de l’histoire” ?
Mais il est vrai que la sociopathie, comme la schizophrénie, est un trouble majoritairement masculin, cela peut jouer sur le fait qu’il y a plus de tueurs en série hommes.
A l’inverse, la bipolarité est davantage féminine, mais l’implication sur le risque de passage de l’acte va être variable.
Lire aussi :
- TEMOIGNAGE Son ex-femme est une meurtrière : les confidences de Philippe Beau
- 8 femmes tueuses en série qui ont fait trembler la France et le monde
- TEMOIGNAGE Surveillante pénitentiaire, elle nous livre les secrets de la prison des femmes