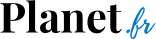Villes gruyère : 7 villes françaises en danger du fait des carrières souterraines

Le terme « ville gruyère » vient directement de nos confrères d’actu.fr : il désigne ces communes dont le sous‑sol est truffé de carrières souterraines, parfois inconnues ou mal cartographiées. Sous la surface, le vide s’accumule, comme les trous dans le fromage. Et un jour, ça craque : un sol qui s’affaisse, un immeuble qui part en pelle‑mécanique… Le phénomène, discret en apparence, menace pourtant un peu partout en France.
Pourquoi y a‑t‑il autant de carrières souterraines en France ?
En remontant l’histoire, on découvre une France taillée à la pioche : calcaire, craie, gypse… des argiles utilisées depuis l’Antiquité, exploitées à ciel ouvert, puis sous la terre au fil des besoins (construction, plâtre, agrandissement urbain) . À Paris, ce sont les carrières de craie et de gypse, exploitées depuis des millénaires, reliées par des réseaux de galeries étendues, sécurisées à coups de remblais et voûtes depuis le XVIIIᵉ siècle : les Catacombes. En province, régions crayeuses comme le Nord‑Pas‑de‑Calais ou la Lorraine regorgent de galeries minières, souvent oubliées.
Vivre dans une ville gruyère, c’est dangereux ?
Le risque majeur ? L’effondrement : les fontis (effondrements d'une galerie souterraine) surviennent quand le toit des galeries cède soudainement. L’eau, le gel, la corrosion minérale affaiblissent les parois . Ainsi, à Clamart et Issy‑les‑Moulineaux en 1961, la venue de la pluie sur des carrières de craie non stabilisées a provoqué un séisme local : 21 morts, une cinquantaine de blessés, et une partie du quartier avalée en quelques minutes. Depuis, plusieurs autres affaissements, parfois moins dramatiques, ont eu lieu, à Paris notamment, où l’Inspection générale des carrières a dû injecter du béton dans les galeries. Au‑delà du danger immédiat, les brèches sous le sol peuvent compromettre la stabilité des bâtiments, fracturer les réseaux (eau, chauffage), et même augmenter les risques de pollution des nappes souterraines par infiltration. Et avec le changement climatique (pluies intenses, montée de nappes), cette situation pourrait fortement s'empirer.
À qui revient la facture ?
La gestion du phénomène incombe aux élus : maire, inspecteurs, BRGM (service géologique nationale), INERIS (institut de recherche)… On alimente des bases de données, on publie des plans d’exposition aux cavités (PPRn), et souvent, on interdit la construction sur certaines zones. Les notaires doivent en informer les acheteurs. Mais l’arsenal juridique est encore parcellaire : certaines carrières sont inconnues, leurs archives perdues. Résultat : sous‑évaluation des risques.
Paris

On ne présente plus les Catacombes ! Plus de 3 000 hectares de carrières exploitées (craie, gypse, calcaire), touchant près de 70 communes de la petite couronne.
Clamart

Site d’un dramatique effondrement en juin 1961 avec 21 morts, comme mentionné plus haut.
Issy‑les‑Moulineaux

Concernée par le même événement tragique, avec une grande concentration de carrières.
Chinon

Ses carrières de tuffeau pour le château et les caves de ville causent des fontis et effondrements ponctuels.
Orléans

L’abandon des carrières provoque des effondrements, favorisés par racines et infiltrations.
Rennes

Lors du chantier du métro, Rennes a connu neuf effondrements sur la chaussée en 1998 et 1999, dus aux cavités et remblais urbains.
Chelles

Autour du fort, Chelles observe un réseau de galeries abandonnées classées à aléa très élevé par le BRGM.