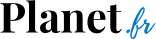Violée en réunion à 17 ans, elle a refusé le huis-clos lors du procès de ses agresseurs

Pour obtenir justice, un long combat l'attend, mais Claudine est prête. Lors du procès, à peine majeure, elle exige que le huis-clos soit levé. Une première, en France, pour des faits de viol sur mineure. Elle a accepté de nous raconter son histoire, et son combat.
En février 1984, Claudine Cordani est une jeune lycéenne de 17 ans. Elle habite à Paris et décide, un soir, de rejoindre des amis dans le 19ème arrondissement. A quelques mètres de sa destination, elle est enlevée sous la menace d’une arme par deux hommes, qui la violent en pleine rue avant de la séquestrer dans un appartement, où un troisième homme est présent.
Après plusieurs heures de cauchemar, Claudine parvient à s’échapper. Elle se rend dans l’heure au commissariat. Pour elle, porter plainte est une évidence. Grâce aux informations qu’elle a réussi à obtenir de ses violeurs, l’enquête avance vite. En moins de 24 heures, deux de ses agresseurs sont arrêtés.
Claudine Cordani : « Tu bouges, et on te bute »
Un an plus tard, les trois hommes sont jugés devant les assises de Paris. En France, le viol est considéré comme un crime depuis quatre ans. Lorsque Claudine apprend qu’étant mineure au moment des faits, le procès se tiendra à huis-clos, elle bondit. Non, elle ne veut pas se cacher. La honte doit changer de camp. Sa décision fait date : c’est la première mineure à refuser le huis-clos. Les trois jours d’audience seront ouverts au public. Au terme des débats, ses violeurs écopent de cinq, dix et douze ans de réclusion criminelle.
Depuis, Claudine n’a cessé de se battre contre les violences sexuelles, et pour une meilleure prise en charge des victimes. Elle nous raconte son histoire, et ses combats.
Que s’est-il passé-t-il le soir de votre viol ?
Claudine Cordani : J’avais 17 ans. J’étais encore au lycée, j’avais redoublé. Et puis un soir de février 1984, je sors tôt vers 20 heures, pour rejoindre une bande de copains dans le 19ème. Je ne suis jamais arrivée. A quelques mètres seulement de ma destination, j’ai été braquée dans la rue par un homme au niveau du métro Jaurès, devant l’ancienne Rotonde. Tout de suite, un deuxième est venu. Ils m’ont menacé avec une arme à feu, et m’ont embarqué à pied.
Ils m’ont dit de marcher devant eux. On a croisé une voiture de police et là ils m’ont dit : « tu bouges, et on te bute ». J’ai été violée dans la rue très vite, le long du canal. Ils m’ont ensuite emmené dans leur cité du 19ème, niveau Ourcq, et ils m’ont violée à nouveau sur place. Il y avait également un troisième homme qui était présent dans l'appartement.
Comment avez-vous réussi à leur échapper ?
Ça a été une histoire incroyable pour m’en sortir. Apparemment, le plan du meneur, le plus dangereux, c’était de me mettre sur le trottoir. Il avait demandé à la personne chez qui on m’avait donc séquestrée de me « garder » jusqu’au petit matin.
Quand mes deux violeurs sont partis, j’ai eu un coup de chance énorme. Alors je me rhabillais, deux jeunes hommes sont venus dans l’appartement et m’ont vue, et j’ai compris qu’ils n’étaient pas copains avec mes violeurs. Ils m’ont balancé leurs noms, ils m’ont dit : « ces mecs c’est des pourritures », et ils ont appelé la police.
Donc j’ai pu avoir leur nom dans le délai d’un flagrant délit, c’est à dire 48 heures, le cas de figure était « idéal » : mes agresseurs ont été interpellés très vite, l’un chez sa mère, l’autre chez sa copine.
Je savais déjà que j’allais porter plainte. Ces deux jeunes hommes m’ont facilité la tâche. J’avais les noms, cela a pu accélérer le dépôt de plainte, et m’éviter de me retrouver dans la rue, à aller au commissariat à pied… Même s’il est impossible de savoir ce qu’il se serait passé s’ils n’étaient pas venus.
Claudine Cordani : « Quand on est violée, on meurt une fois »
Vous trouvez le courage de porter plainte rapidement. C’était important pour vous ?
Claudine Cordani : Pendant le viol, je savais déjà que je voulais porter plainte. J’avais en tête, déjà, qu’il n’était pas sûr que j’en réchappe vivante, c’était très clair. Même si quand on est violée, on meurt une fois. Chaque viol est une mort.
Je n’avais pas peur du traitement de la police, car ça ne pouvait pas être pire que mon viol. Le plus dur pour une victime c’est d’avoir été victime. Bien sûr, c’est très dur de porter plainte, de parler de ce qu’on a vécu, c’est intime et ça ravive des traumas… Mais c’est moindre par rapport à ce qu’on a vécu.
Pendant le viol, j’avais clairement conscience qu’ils n’avaient pas le droit de faire ce qu’ils faisaient. Et quand on n’a pas le droit, la réponse, pour moi, c’est la justice.
J’ai depuis très jeune ce sentiment très fort de justice et d’injustice. Cette notion d’injustice est plus forte que tout, elle éliminé la peur, les craintes, tout le reste.
C’était une évidence, il n’était pas concevable pour moi que leur vie continue comme s’il ne s’était rien passé : il s’était passé un crime. Mon but, c’était aussi et surtout qu’ils ne nuisent à personne d’autre, qu’ils ne soient plus en liberté.
Je n’ai jamais été embêtée par la culpabilité. Les coupables, c’étaient eux, j’en étais convaincue, et je n’ai jamais remis ça en cause. Donc c’était « facile » pour moi d’aller au bout de cette procédure. J’ai tout géré toute seule. Jusqu’au bout. Je ne voulais pas trop que ça se sache, je ne voulais pas être jugée par apport à ça, qu’on me considère comme différente, « salie », qu’on porte sur moi un regard différent, même si malheureusement, on n’y échappe pas.
Avez-vous été prise en charge, épaulée par la justice ?
Oui. J’ai eu la chance de tomber sur un juge d’instruction incroyable, professionnel et d’une grande humanité. Et mon avocat, commis d’office, m’a aussi très bien défendue.
Comme j’étais mineure, mes parents devaient se constituer partie civile. J’ai dit au juge que ça n’était pas possible, qu’il fallait qu’il trouve une solution, ce qu’il a fait. J’ai contacté mon frère ainé qui m’a permis de porter plainte, mais aussi de protéger nos parents. Je me suis débrouillée. Et puis ça a été le procès de ma vie.
Claudine Cordani : « Mes parents n’étaient pas au courant »
Votre entourage était-il au courant ?
Claudine Cordani : Je ne voulais pas que mes parents soient au courant, pour plein de raisons. J’ai senti qu’ils n’avaient pas les moyens de me donner des pistes pour que je sois aidée, eux-mêmes maitrisant mal la langue française. Ma mère était analphabète, mon père italien parlant peu le français, et je n’allais pas trouver ressources suffisantes auprès d’eux.
Et puis, je n’avais pas de très bonnes relations avec ma mère à l’époque, elle me traitait souvent de « bonne à rien », et je n’avais pas envie de lui dire que j’avais vécu cela. J’ai su par la suite, bien plus tard, que ma mère avait été elle-même victime de viol, et j’ai senti que, peut-être, nos relations avaient été difficiles en partie à cause de cela.
On peut avoir des femmes dans son entourage, et ne pas être soutenue par elles. Surtout, les gens au sein des familles ne sont pas assez formés sur ces questions-là. On laisse des générations de filles, mères, et grand-mères sans les moyens d’en parler, et ça créée des situations douloureuses, comme celle que j’ai vécu.
Au moment du procès, vous refusez le huis-clos, une première en France pour une mineure. Pourquoi ?
Quelque temps avant le jugement, je me suis retrouvée dans le bureau de Pierre Getti, le juge d’instruction, qui m’a informé des dates du procès. Il m’explique que cela va durer trois jours aux assises, et que ça sera à huis clos. Je ne connaissais pas ce terme, alors je lui demande ce que ça veut dire, et il m’explique.
J’ai tout de suite répondu : « ça n’est pas possible. Je veux que tout le monde vienne. Ce n’est pas à moi d’avoir honte, je veux que tout le monde le sache, que la société le sache ». C’était un peu MeToo avant l’heure. Le procès a été suivi par les médias, on en parlé parce que j’étais la première mineure à refuser le huis-clos.
Mon histoire est assez spéciale, d’ailleurs, à plusieurs égards. Je cumule plein de choses : je fais partie de faibles pourcentages de victimes qui portent plainte, qu’on a reconnu en tant que victimes, et la première à avoir refusé le huis-clos. Alors que je ne connaissais même pas l’existence de Gisèle Halimi, pourtant, à l’époque !
Je respecte et je comprends que les victimes refusent de porter plainte et refusent huis clos, mais ça me fait de la peine. Mon positionnement n’a jamais été dit de dire : « faites ceci », je dis simplement aux victimes « je suis désolée, faites au mieux pour vous, pour vous reconstruire ». On n’a rien à exiger d’une victime, on doit lui foutre la paix et respecter ses choix. D’entendre des jeunes qui me disent « je ne vais pas y aller, car les flics ne vont pas bien me recevoir », ça me met hors de moi, c’est pour ça que je suis si active. Moi mon histoire de viol est réglée, mais je veux me battre pour les autres.
Claudine Cordani : « J’ai senti que j’avais un choix à faire, vivre ou mourir »
Comment avez-vous essayé de vous reconstruire ?
Claudine Cordani : C’était difficile. Car quand on est violé, on est mort-vivant. Je pense que ma personnalité, que j’avais déjà à l’époque, m’a aidé. Je négociais plein de choses, j’étais déjà féministe, je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, je ne me gênais pas pour le dire. Et très vite, j’ai senti que j’avais un choix à faire : vivre ou mourir. J‘ai fait le choix de vivre car je suis une personne optimiste, heureuse d’être en vie, je trouve que c’est extraordinaire de vivre, d’apprendre des choses, et personne n’a le droit de m’enlever ça.
Je suis très déterminée, et j’arrive toujours à aller au bout de ce que je veux, et heureusement, ce trait de caractère m’a beaucoup aidé. J’ai toujours lutté, pour l’égalité des genres, pour avoir les mêmes droits que mes frères, pour défendre ma place dans ce monde. Mon combat m’a aidé à rester debout : ils ne gagneront pas, ça ne suffit pas qu’ils aient été en prison, il ne faut pas que je rate ma vie. Et j’ai tenu ma promesse.
J’ai aussi trouvé refuge dans les livres, et je suis entrée à la Chambre typographique parisienne, où j’ai été formée à plusieurs métiers, dont maquettiste typographe. Après ma carrière dans le journalisme, je me suis tournée vers l’art du collage engagé, cela m’a beaucoup aidé. C’était une occupation qui me faisait du bien, pas chère.
J’expose d’ailleurs à Paris pour la première fois. Ce sont des collages engagés sur toutes les thématiques qui sont chères. L’expo s’appelle « kintsugi paper » : le kintsugi est un art japonais qui consiste à réparer une porcelaine brisée avec de la peinture d’or. C’est un symbole de résilience. Et moi, je fais un peu ça avec du papier !
Vous sortez de l’anonymat et décidez de témoigner en 2019. Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons : n’étant plus journaliste depuis fin 2017, j’avais retrouvé une forme de liberté dans ma parole. Je suis passée du rôle de journaliste à celui de « source ». Je savais que je voulais écrire un livre sur mon parcours, et je l’écrivais intérieurement depuis des années.
Comme j’avais arrêté de travailler comme journaliste, j’avais du temps pour réfléchir, et puis j’ai vécu des moments personnels très durs, donc je suis montée au créneau. Je me suis dit : c’est le moment, j’avais besoin de libérer ma parole. Et puis j’ai suivi les premiers évènements de Nous Toutes, l’organisation de Caroline de Haas, et je me suis dit qu’il se passait enfin un truc, et ça faisait longtemps que j’attendais ça.
C’était une façon de dire : voilà ce que j’ai fait, et pourquoi je l’ai fait. Je veux être utile pour les autres victimes.
Quels sont vos combats aujourd’hui ?
On ne peut pas me résumer à une activité, je suis éco féministe-activiste !
Je me sus formée comme écoutante au Collectif féministe contre le viol. Je suis sollicitée régulièrement sur Twitter, il m’est arrivé d’accompagner des mineurs au commissariat. Tout ce que je peux apporter aux victimes, je le fais.
Mon principal combat, c’est l’injustice dans le monde. Si on règle injustice à tous les niveaux, on peut arriver à un système qui respecte tous les vivants.
Je suis très active, vu mon histoire vis-à-vis des victimes de viol, mais je suis aussi engagée pour toutes les causes relatives aux droits, tous les droits, les droits du vivant.
Je me suis toujours sentie concerné par ce qui se passait autour de moi, dans le monde. Ma sensibilité a fait le reste. Je fais preuve d’empathie, je comprends ce que les gens ressentent. Comment faire pour que les personnes souffrent moins, c’est cela qui m’intéresse.
Il existe de nombreuses de corrélations entre la façon dont on traite les gens et façon dont on traire la planète. L’être humain n’est pas respectueux. On est mal éduqués. Le résultat c’est une culture du viol entretenue, alors qu’en 2022, on devrait être à l’inverse de ça.
Tant qu’on sera capable de laisser faire la violence, on sera capable de laisser faire tout le reste.
Kintsugi paper, une histoire graphique de la résilience et de l’écoféminisme
Claudine Cordani expose ses collages du 24 mai au 19 juin à la Cité audacieuse, 9 rue de Vaugirard, Paris 6ème arrondissement.