
Ce week-end, les conditions météorologiques seront instables dans l’hexagone. Bien que les températures seront plus douces, de fortes perturbations provoquées par “une goutte froide” sont attendues....
Découvrez toute l'actualité politique en France et à l'international sur Planet.fr. Notre rubrique dédiée vous offre une couverture complète des événements politiques, des élections, des décisions gouvernementales et des débats qui façonnent le monde politique. Restez informé(e) des dernières nouvelles concernant les partis politiques, les personnalités politiques, les réformes législatives et les enjeux politiques majeurs. Que vous soyez passionné(e) par la politique française ou que vous vous intéressiez aux affaires politiques à l'échelle mondiale, Planet.fr vous fournit des analyses approfondies, des interviews exclusives et des commentaires éclairés. Suivez les évolutions du paysage politique et comprenez les enjeux qui impactent notre société.
Découvrez encore plus d'actualités, en vous abonnant à la newsletter de Planet.
Votre adresse mail est collectée par Planet.fr pour vous permettre de recevoir nos actualités. En savoir plus.

François Ruffin, député de la Somme, cultive sa différence. Son objectif : travailler avec les autres partenaires de gauche et s'organiser pour 2027. Un sondage le donne...

Récemment propulsée porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, Prisca Thevenot s'apprête déjà à renouveler un tiers des membres de son cabinet. Qui est cette ministre...

Au Sénat, des élu.e.s de gauche ont déposé une proposition de loi visant à abroger la dernière réforme des retraites, mais celle-ci a été jugée irrecevable. Une...

C'est un sujet qui fait débat depuis quelques jours : la taxation des rentes. Ce mercredi 9 avril, Gabriel Attal a apporté des précisions sur les personnes concernées...

D'étranges symptômes touchent depuis près de 10 ans des membres de la communauté du renseignement et des diplomates américains. Il s'agirait, selon une enquête de CBS,...

Jean-Marie Le Pen, ex-chef du Front national (FN), est placé depuis le mois de février 2024 " sous régime de protection juridique ", faisant l'objet d'un mandat de protection...

David Djaïz, ex-conseiller à l'Élysée, dévoile son ouvrage “La Révolution obligée”. L'essayiste se confie sur ses désillusions sur la classe politique et tous...

Du piano à l'urine en passant par les barbes, nombreux sont les motifs plus insolites les uns que les autres qui ont justifié (et justifient encore) des impôts et taxes...

Le 26 mars dernier, l'Insee a dévoilé le déficit public de l'Etat qui s'élève à 5,5%, soit 154 milliards d'euros. Une dégradation loin des prévisions du gouvernement...

Le patron des enseignes E.Leclerc envisagerait de se lancer en politique. Il n'en est pas à sa première incursion dans le débat public. Portrait.

Au lendemain de la publication des chiffres inquiétants de l'Insee sur le déficit public, Gabriel Attal était l'invité, ce mercredi, du JT de 20 heures de TF1. Le Premier...

Les obsèques de l'ancien ministre Frédéric Mitterrand se sont déroulées ce mardi 26 mars, à Paris, en présence de ses proches, de personnalités politiques et culturelles...

À l'heure où les dépenses sociales, comme celles de l'assurance chômage, sont dans le viseur de l'exécutif, quelles annonces pourraient faire le Premier ministre ce...

Ce mardi 26 mars, l'Insee dévoile le chiffre définitif du déficit public de l'Etat qui s'élève à 5,5%. Face à cette augmentation, Bruno Le Maire évoque “des efforts...

Malika Sorel-Sutter devient la numéro 2 sur la liste du Rassemblement Nationale pour les élections européennes de 2024, le 9 juin prochain. Cette essayiste française,...

Le vice-président du Parlement russe, Piotr Tolstoï, arrière-petit-fils de Léon Tolstoï, a évoqué la possibilité d'envoyer une frappe nucléaire sur Paris en "deux...
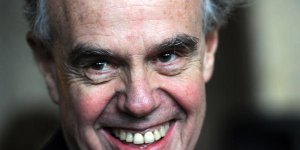
L'ancien ministre de la Culture et homme de télévision Frédéric Mitterrand est décédé ce jeudi 21 mars. Après une longue lutte contre un cancer agressif, il est mort...

Le mercredi 20 mars, Emmanuel Macron s'est entretenu avec plusieurs ministres au sujet du déficit budgétaire qui s'est creusé. Un chiffre nettement supérieur aux prévisions...

Le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, dans une interview accordée à BFTMTV, menace la France et le président de la République avec l'envoi de troupes françaises...

Ce mercredi 20 mars, Emmanuel Macron présidera une cérémonie d'honneurs funèbres militaires aux Invalides, en hommage à Philippe de Gaulle, le fils de général de Gaulle,...

L'ancienne ministre de l'Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem, propose de "rationner" internet. Elle souhaite limiter l'utilisation d'internet à trois gigas par...

Olivier Véran, jusqu'ici neurologue de formation, va désormais se tourner vers la médecine esthétique. Une nouvelle activité qu'il exercera un jour par semaine, mais...

Et si François Hollande se représentait à la présidentielle en 2027 ? Même s'il dément les rumeurs, son air badin et sa surprise feinte suggèrent tout le contraire....

La France enverra 81 députés au Parlement européen après les élections de juin 2024. Plusieurs partis ont déjà désignés leurs candidats. Trombinoscope.

Entre le Château et Matignon, que se passe-t-il à table pendant les déjeuners du gouvernement ? Voici les coulisses des repas hebdomadaires entre président et son Premier...

Le président de la République s'est exprimé à l'issue d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine, deux ans après le début de la guerre contre la Russie....

Propulsé par Marine Le Pen et aujourd'hui à la tête du RN à seulement 28 ans, Jordan Bardella, est devenu l'homme de confiance de la principale adversaire d'Emmanuel...

En plein salon de l'agriculture, thermomètre des popularités des politiques, un sondage Odoxa-Mascaret de février pour LCP, Public Sénat et 20 titres de la presse quotidienne...

L'ouverture du 60ᵉ Salon de l'Agriculture a été agitée pour le président Emmanuel Macron. Des manifestants ont forcé l'entrée et ont provoqué des heurts sur les...

En laissant filtrer une information sur une invitation du mouvement Les Soulèvements de la Terre au débat organisé au Salon de l'Agriculture, Le chef de l'Etat a attisé...

Les réseaux sociaux russes relayent une rumeur d'un projet d'attentat durant la prochaine visite d'Emmanuel Macron en Ukraine. La raison : la visite reportée du président...

Depuis 2020, Gérald Darmanin est marié à Rose-Marie Devillers. Rencontre, enfants, obstacles... Portrait d'un couple discret.

L'ex ministre débarqué du gouvernement, où il a successivement occupé le poste de ministre de la Santé et porte-parole Olivier Véran , retrouve l'Assemblée nationale....

Avant l'ouverture du Salon de l'agriculture, samedi 24 février, les syndicats d'agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement. Tour de France des points de...

Après un mois d'attente, le gouvernement de Gabriel Attal est finalement au complet. Rachida Dati, Sébastien Lecornu, Nicole Belloubet... Les ministres sont-ils des coeurs...
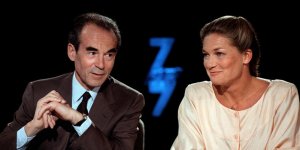
Robert Badinter, ancien ministre de la Justice, s'est éteint à l'âge de 95 ans, vendredi 9 février 2024. Il formait un couple avec Élisabeth Badinter avec qui il était...

L'équipe menée par Gabriel Attal compterait 17 millionnaires, soit la moitié de l'effectif, selon une enquête publiée par l'Humanité. Découvrez qui figurent parmi...

Un conseiller de l'exécutif a révélé à l'AFP ce dimanche qu'un nouveau «pack» de ministres pour compléter le gouvernement pourrait être très bientôt annoncé....

Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova sont les deux filles de Vladimir Poutine, nées de son union avec Lioudmila Alexandrovna Chkrebneva. Que sait-on de ces femmes visées...

Gabriel Attal se prépare à prendre la parole devant l'Assemblée nationale ce mardi 30 janvier pour son discours de politique générale. Cependant, selon les informations...

Depuis plusieurs semaines désormais, la fronde menée par les exploitants des quatre coins de l'Hexagone est représentée par plusieurs fortes personnalités. Mais qui...

Au cœur des principales revendications des agriculteurs, on retrouve les lois Egalim. Mais quelles sont ses objectifs, et que réclament les exploitants agricoles à son...

Alors que les agriculteurs manifestent et bloquent les principaux axes routiers ce 29 janvier, d'autres professions pourraient également rejoindre le mouvement sur nos routes....

Le Premier ministre Gabriel Attal prononcera son discours de politique générale ce mardi à 15 heures. Un exercice très attendu, qui sera scruté de très près.

Marlène Schiappa aurait-elle trouvé sa voie ? Depuis son départ du gouvernement en juillet dernier, les projets de l'ancienne ministre s'enchaînent et ne se ressemblent...

L'Assemblée nationale a décidé mercredi 24 janvier 2024 d'augmenter de 300 euros les frais de mandat mensuels des députés. Une décision qui passe mal en pleine crise...

La seconde vague de nominations au gouvernement, celles des ministres délégués et des secrétaires d'État, sera dévoilée juste après le discours de politique générale...

Moins de quinze jours après avoir été nommée ministre de l'Éducation, Amélie Oudéa-Castéra a beaucoup fait parler d'elle dans l'espace médiatique. De scandale en...

Gabriel Attal compte des membres de sa famille très connus. Une de ses cousines en particulier. Voici de qui il s'agit et quels liens ils entretiennent.

L'Ipsos et le journal « La Tribune » ont publié leur baromètre politique pour le mois de janvier 2024. Découvrez comment les premiers pas du Premier ministre ont été...

Depuis quelques jours, une vague de mécontentement secoue le monde agricole, marquée par des manifestations et des blocages, notamment en Haute-Garonne où l'autoroute...

Invité sur le plateau du journal de 20H de TF1 ce dimanche, le ministre de l'Economie était interrogé sur les sujets brûlants qui anime l'actualité ces dernières semaines....

Une semaine après la première phase du remaniement, plusieurs ministères demeurent inoccupés. Les secrétaires d'État, eux, attendent d'être fixés sur leur sort. Le...

Lors de sa conférence XXL le président de la République Emmanuel Macron a annoncé une baisse d'impôts de deux milliards pour les classes moyennes dès 2025. Voici ce...

A peine nommé, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal est scruté de toutes parts jusqu'à son hygiène : nuits blanches, Coca, cigarette électronique... Le docteur...

Rachida Dati a-t-elle passé un "deal" avec Emmanuel Macron pour s'assurer la mairie de Paris en 2026 ? Si la principale intéressée le dément avec la fermeté qu'on lui...

Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse ce mardi à 20 h 15 depuis l'Elysée sur TF1, France 2 et les chaînes d'information. Après une année 2023 difficile,...

Notre nouveau Premier ministre, à seulement 34 ans, a-t-il l'étoffe nécessaire pour assumer cette fonction de haute responsabilité ? Que vous soyez féru d'astrologie...

Patron du parti Renaissance et chef de file des eurodéputés macronistes, ce fidèle du chef de l'État succède à Catherine Colonna au ministère de l'Europe et des Affaires...

À peine nommé Premier ministre, Gabriel Attal, politique au parcours fulgurant, sera-t-il le prochain président de la République ? En-rêver, oui. Mais de là à remporter...

Nommée ministre de la Culture ce 11 janvier 2024, Rachida Dati attire tous les regards. Mais à quoi ressemblait cette figure de la droite il y a 20 ans ? Découvrez les...

Fraîchement élu Premier Ministre du gouvernement, Gabriel Attal a tenu son premier discours télévisé sous cette fonction au journal de TF1 hier soir. Voici ce qu'il...

Véritable surprise du dernier remaniement, Rachida Dati est la nouvelle ministre de la Culture. Si par le passé elle a occupé différents postes, le montant de sa fortune...

Selon Europe 1, la formation du cabinet de Gabriel Attal est imminente, comme le démontre l'arrivée d'Emmanuel Moulin. Proche de Bruno Le Maire, spécialiste en économie,...

Mardi 9 janvier, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre. Il devient ainsi le plus jeune homme politique à occuper ce poste sous la Ve République. Quel salaire gagnera-t-il...

Depuis sa nomination, les rumeurs courent quant aux nominations des prochains ministres. Toujours sans annonce officielle du gouvernement, l'attente se fait ressentir. Voici...

Contrairement au Premier ministre, les ministres sortants, lors d'un remaniement, ne bénéficient pas d'avantages matériels. Ils conservent toutefois une rémunération...

La scène politique française voit émerger une nouvelle figure avec le jeune Gabriel Attal, tout fraîchement promu Premier ministre à seulement 34 ans. Au-delà de son...

Elisabeth Borne a été à la tête du gouvernement pendant 1 an, 7 mois et 23 jours. Une fois partie de Matignon, que gagnera l'ex-Premiere ministre à la retraite ? Bénéficiera-t-elle...

Gabriel Attal a finalement été choisi par Emmanuel Macron pour tenter de relancer son second quinquennat. Si certains ministres devraient garder leur poste, d'autres pourraient...

Le lundi 8 janvier 2024, Elisabeth Borne a donné sa démission à Emmanuel Macron. En plus de conserver bon nombre de ses avantages de Première ministre, l'ex-cheffe du...

Emmanuel Macron a reçu les responsables des cultes à l'Élysée pour les traditionnels meilleurs vœux. Ce fut l'occasion de revenir sur le sujet épineux de la fin de...

Gabriel Attal vient d'être nommé Premier ministre. Devenu le plus jeune de l'histoire de la Ve République, est-il également le plus riche du gouvernement ?

Alors qu'Elisabeth Borne a donné sa démission et qu'un remaniement approche à grands pas, les oppositions parlent d'un"non-événement". Voici les principaux discours...

Élisabeth Borne n'est plus Première ministre. La cheffe du gouvernement a présenté sa démission à Emmanuel Macron qui l'a acceptée ce lundi 8 janvier 2024. Plus de...

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs de remaniement gouvernemental se propagent, avec des signes laissant présager des changements imminents. Une réunion entre le chef...

Remerciements lors des vœux de fin d'année, annulation du premier Conseil des ministres de 2024... Plusieurs indices nourrissent les rumeurs d'un remaniement imminent....

Lors de ses vœux présidentiels, Emmanuel Macron a promis "une année de détermination" pour 2024. En difficulté depuis le début de son second quinquennat, le président...

Entré en vigueur avec la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 49.3 permet au chef du gouvernement de faire passer un texte sans vote. Voici les Premiers ministres qui...

Durcissement des conditions du regroupement familial, modification de l'accès aux prestations familiales, remise en cause de l'automaticité du droit du sol… Quelles mesures...

L'Élysée a annoncé ce dimanche 31 décembre le report du Conseil des ministres prévu le 3 janvier à la semaine suivante. De quoi relancer à nouveau les rumeurs sur...

Première dame depuis un peu plus de 6 ans désormais, l'ancienne prof de français a été encore plus présente sur la scène médiatique cette année. Découvrez ses plus...

Souvent de mauvaise foi, rarement bienveillantes mais toujours un peu vraies, les punchlines des politiques ont rythmé l'année. A l'occasion du passage en 2024, nous vous...

Quelles personnalités politiques choisirez-vous pour aller boire une bière ? C'est le sujet du dernier sondage réalisé par l'agence CorioLink en partenariat avec l'IFOP...

En pleine tempête aussi bien politique que médiatique, le gouvernement semble plus que jamais fragilisé. Au premier rang, l'avenir de la Première ministre paraît compromis....

Seulement quelques jours après l'adoption de la loi immigration, le chef de l'Etat s'est envolé pour le traditionnel repas de Noël aux côtés des troupes françaises....

Plusieurs ministres ont exprimé leur désaccord à l'égard du nouveau texte sur la loi immigration, adopté le mardi 19 décembre 2023. Ce vote a laissé apparaître des...

32 départements de gauche n'appliqueront pas le durcissement des conditions de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie prévu dans la loi immigration. Qui sont-ils...

Emmanuel Macron était l'invité, ce mercredi soir, de "l'émission C" à vous sur France 5. Le président est revenu sur l'adoption de la loi immigration au Parlement, mercredi...

Au lendemain du vote sur la loi immigration, le président prendra la parole à 19h ce mercredi sur C à Vous (France 5) pour conclure une année 2023 politiquement...

Invitée ce matin sur France Inter, la Première Ministre Élisabeth Borne a apporté des explications sur la Loi d'Immigration. Elle a également parlé d'adapter certaines...

Après plusieurs heures de débat, la majorité est finalement parvenue à trouver un accord avec les LR, lors de la commission mixte paritaire (CMP). Ensuite, tout s'est...

Un député en colère a fait livrer des croquettes pour chien à Emmanuel Macron. Découvrez ses raisons.

Après l'échec retentissant du début de semaine avec l'adoption de la motion de rejet sur la loi immigration, le Gouvernement pourrait essayer un nouveau coup dur. A la...

L'actuel ministre de l'Intérieur, en pleine tourmente à l'Assemblée sur la séquence de l'immigration, s'est confié pour le média Brut sur son avenir et celui de la...

À l'occasion de la fête juive de Hanouka, le grand rabbin de France a allumé, jeudi 7 décembre, une bougie à l'Elysée en présence d'Emmanuel Macron. Une scène qui...

Cette année encore, le prix "Press club, humour et politique" récompense les punchlines les plus drôles des politiques pour l'année 2023. Qui succèdera à Fabien Roussel...

La Première ministre Elisabeth Borne a passé des consignes aux ministres et aux secrétaires d'État, et à leurs équipes. Les messageries étrangères WhatsApp, Signal...

Hormis les nombreuses utilisations de l'article 49-3 de la Constitution, Elisabeth Borne et son gouvernement totalise un nombre de records jamais vus. D'après une enquête...

Une fois n'est pas coutume, la Première ministre a une nouvelle fois été surprise en train de vapoter dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Au lendemain de l'annonce...